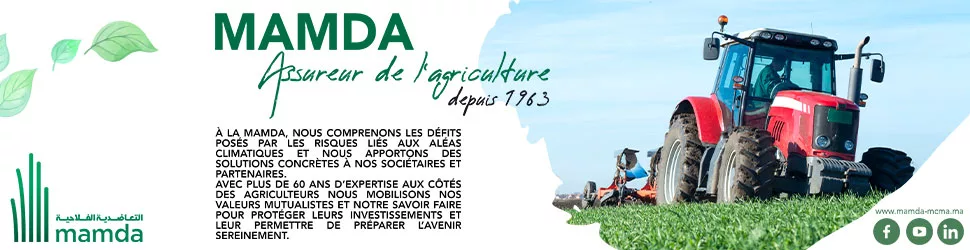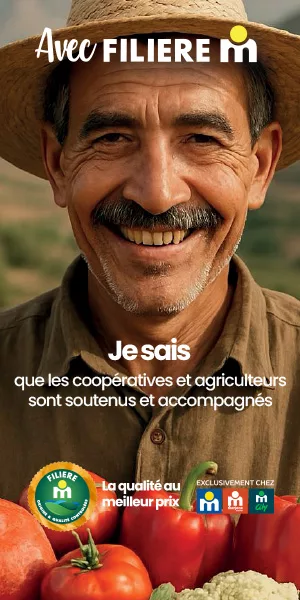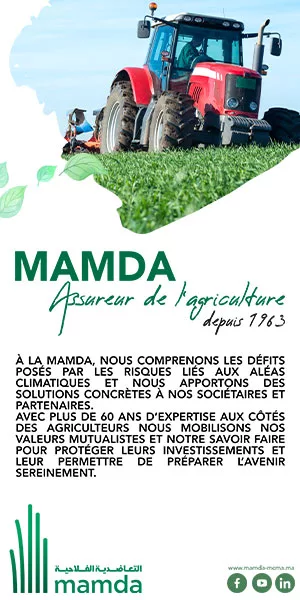Dans le Sud profond du Maroc, à la lisière du désert du Sahara, une scène inhabituelle a attiré les regards : une cinquantaine de bénévoles, munis de gants et de sacs-poubelle, ont entrepris de nettoyer les abords de M’Hamid El Ghizlane, porte d’entrée du désert et village emblématique de la culture nomade.
Cette opération s’est déroulée à l’occasion de la 20e édition du Festival international des nomades, organisé mi-avril dans cette localité oasienne de la province de Zagora. En quelques heures, près de 600 kilos de déchets ont été retirés du sable, entre bouteilles en plastique, emballages alimentaires et résidus en tout genre, vestiges indésirables du passage humain dans cet environnement fragile.


« On parle souvent de la pollution des plages ou des forêts, mais on oublie que le désert aussi souffre », explique Nouredine Bougrab, fondateur du festival et habitant du village. Pour cet enfant du désert, cette campagne de ramassage n’est pas qu’un geste symbolique : elle constitue un véritable plaidoyer en faveur de la sauvegarde des espaces arides, aussi vulnérables que méconnus dans les politiques environnementales.
Le point de départ de cette opération a été la zone nord de M’Hamid, particulièrement affectée par les déchets. Les participants – artistes, militants, habitants, touristes – ont ensuite progressé jusqu’aux confins de la commune, à la frontière du Grand Désert. Une manière de marquer la transition entre l’espace habité et l’immensité saharienne, aujourd’hui menacée par l’omniprésence des plastiques et autres polluants.
Selon Mustapha Naimi, anthropologue spécialiste des sociétés sahariennes, les déchets plastiques sont devenus un fléau majeur pour l’écosystème désertique : ils contaminent sols, points d’eau et pâturages, compromettant la survie de la faune locale et des activités pastorales. Les vents, omniprésents dans la région, amplifient cette contamination en dispersant les résidus sur des kilomètres.
Le Maroc, avec une production annuelle estimée à 8,2 millions de tonnes de déchets ménagers, peine encore à maîtriser le recyclage : seuls 6 à 7 % de ces déchets sont valorisés, selon Hassan Chouaouta, expert en développement durable. « C’est comme si l’on remplissait près de 2.800 piscines olympiques chaque année », illustre-t-il.
Pour Ronald Le Floch, photographe français installé à New York et participant à l’opération, cette mobilisation est un acte de responsabilité. « Le désert est un espace de silence, de beauté, mais aussi de grande fragilité. Il est urgent de le protéger », témoigne-t-il.
L’enjeu est aussi humain. Ousmane Ag Oumar, musicien malien du groupe touareg Imarhan Timbuktu, rappelle que ces déchets menacent directement les troupeaux, essentiels à la subsistance des communautés nomades. Or, ce mode de vie ancestral est en péril : selon les derniers chiffres de 2014, le Maroc ne compte plus que 25.274 nomades, soit une chute de plus de 60 % en une décennie.
Une désertion silencieuse que déplore Mohammed Mahdi, professeur de sociologie rurale, pointant un désengagement de l’État envers ces populations. « Les éleveurs nomades reçoivent peu d’aides, contrairement à l’agriculture tournée vers l’export. Résultat : nombre d’entre eux abandonnent. »
Mais à M’Hamid, l’espoir renaît. Mohamed Oujâa, leader du groupe de musique gnaoua Les pigeons du sable, voit dans cette campagne un signal fort : « Il faut un désert propre pour les générations futures. Cette initiative n’est que le début. Il faut continuer. »
Dans un Maroc en pleine transition écologique, le désert, trop longtemps ignoré, pourrait bien redevenir un symbole de conscience collective et d’engagement citoyen.