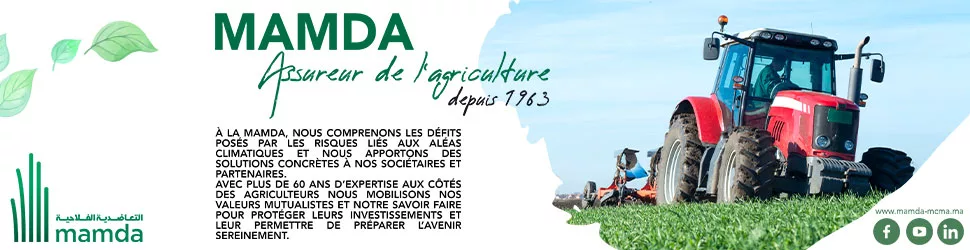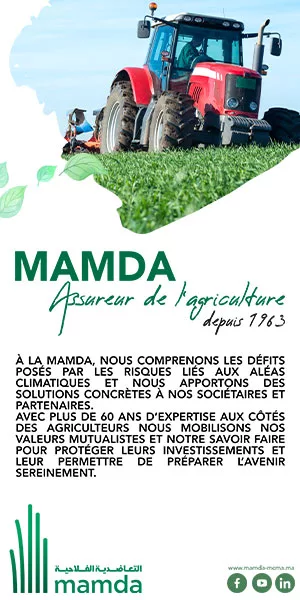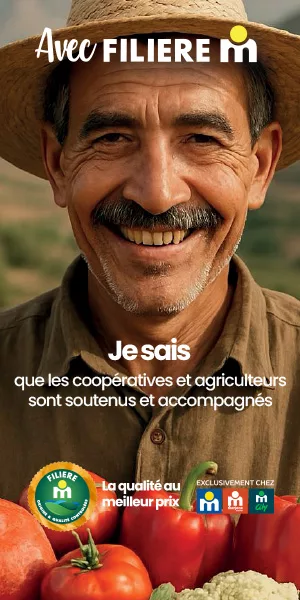À quelques encablures du Morocco Mall, dans un quartier de Casablanca en pleine effervescence liée aux préparatifs de la CAN 2025 et du Mondial 2030, un autre chantier attire moins les regards, mais pourrait bien réécrire une page majeure de l’histoire humaine. Sur le site archéologique de la carrière Thomas I, des chercheurs marocains et français s’activent dans le cadre du programme “Préhistoire de Casablanca” pour exhumer des vestiges uniques datant de près d’un million d’années.
Piloté par l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP), en partenariat avec le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Université Paul Valéry de Montpellier et le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, ce projet scientifique s’impose comme une référence dans l’étude de l’Humanité ancienne en Afrique du Nord.
Du 2 au 17 avril, une mission de terrain a permis de restaurer un fossile exceptionnel : un crâne de rhinocéros vieux de 900.000 ans, découvert dans la grotte des Rhinocéros, située sur le site voisin d’Oulad Hamida 1. Ce fossile, rare par son état de conservation, fait l’objet d’un travail minutieux dans un laboratoire mobile installé sur le site. Une restauratrice paléontologique y reconstitue pièce par pièce le crâne, utilisant un mélange de sédiment local et de résine acrylique, afin de préserver au mieux sa lisibilité scientifique.
Ce n’est pas seulement un squelette que les chercheurs reconstituent, mais tout un pan de l’histoire environnementale de la région. Des analyses poussées, telles que l’étude des micro-usures dentaires ou des isotopes, permettent de reconstituer l’alimentation des animaux préhistoriques et d’en déduire les paysages qu’ils fréquentaient : savanes, forêts, zones humides… Chaque fragment devient une piste, chaque dent un témoignage de l’écosystème d’antan.
Cette restauration pourrait également contribuer à résoudre une énigme archéologique : pourquoi autant de rhinocéros dans cette grotte ? L’espèce n’est pas adaptée à la vie souterraine, et aucune trace de chasse humaine directe n’a été identifiée. Plusieurs hypothèses sont à l’étude, notamment celle d’un déplacement post-mortem des carcasses par des crues ou d’autres animaux.
Ces recherches s’inscrivent dans une démarche plus large de valorisation du patrimoine archéologique marocain. Casablanca, bien que perçue comme un symbole de modernité et de dynamisme urbain, abrite un potentiel préhistorique unique en Afrique du Nord. La région recèle plusieurs sites majeurs comme Ahl Al Oughlam (2,5 millions d’années), la grotte à Hominidés (780.000 ans), ou encore la fameuse carrière de Sidi Abderrahmane, où a été découverte en 1955 une mandibule humaine datant de 350.000 ans.
Le crâne restauré sera prochainement exposé au Parc de Préhistoire de Sidi Abderrahmane, actuellement en cours de réaménagement. Ce lieu deviendra une vitrine du patrimoine paléontologique marocain, à l’heure où le pays s’ouvre aux grands rendez-vous internationaux. Une manière de faire dialoguer le passé le plus lointain avec les ambitions futures de la nation.